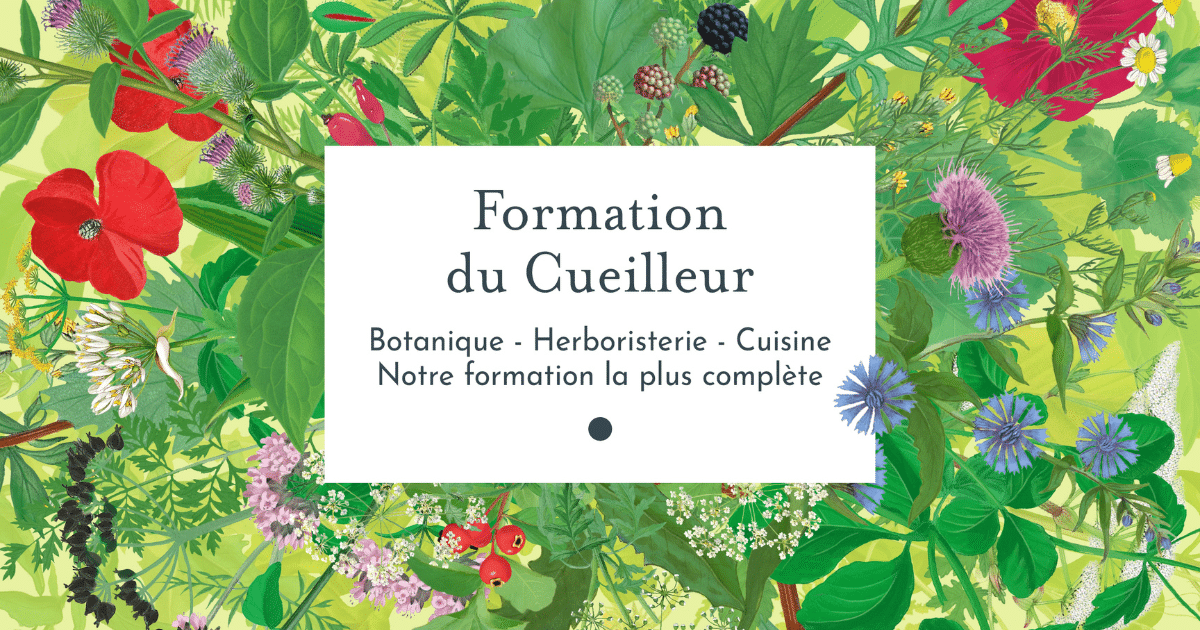La consoude officinale (Symphytum officinale) ou grande consoude est une plante médicinale traditionnellement utilisée depuis plus de 2000 ans1.
Elle n’est pas recommandée comme comestible, mais elle peut quand même nous rendre quelques services. C’est surtout sa racine que l’on utilise traditionnellement en alcoolature pour les contusions.
Elle possède des propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires et analgésiques démontrées1,2.
Ses feuilles peuvent servir de paillage au jardin et ses fleurs appréciées des oiseaux : merci la consoude ! Comme la bourrache ou la vipérine, elle fait partie de la famille des Boraginacées. Très commune en Europe, elle forme des colonies proches des lieux humides.
La consoude a été utilisée traditionnellement pour accélérer la cicatrisation et pour consolider les fractures. En effet, le nom latin “Symphytum” dérive du grec “symphis” qui signifie “union, cohésion” et “phyton” qui signifie “plante”. Le nom vernaculaire consoude vient du latin “consolida”3. Son efficacité réelle reste cependant à objectiver.
De l’Antiquité à la Renaissance : une vérité fragile
Dans l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien, le nom de consoude utilisé chez les grecs se réfère en réalité à Coris monspelliensis ou Symphyton des pierres. Pline lui associe la propriété de réparer les os fracturés4. Il y a donc pu avoir un lapsus entre le nom grec et l’usage associé par la suite dans l’histoire.
En effet, la racine de grande consoude utilisée en cataplasme jouissait d’une réputation très populaire au Moyen-Âge pour guérir les os brisés5.
Au XVIème siècle, dans son chapitre dédié aux “Douleurs et fractures”, Mattioli préconise de piler la racine de grande consoude et de l’appliquer sur la partie concernée6.
Des avis controversés du XIXème au XXème siècle
Mais au XIXème siècle, cet usage de la grande consoude est très controversé, voire absent des ouvrages référents de l’époque.
Pour Cazin, ses propriétés relèvent d’une “haute opinion” loin d’être justifiée qui résulte “d’erreurs de crédulité de la part des anciens”. Selon ce dernier : “le plus simple examen suffit à le démontrer”7. Dans les ouvrages respectifs de Duchesne et de Egasse et Dujardin, l’usage en cataplasme contre les fractures est passé sous silence bien que la grande consoude soit reconnue comme une plante médicinale8,9. Chez Rodin, l’espèce ne figure même pas dans la liste de sa pharmacopée10.
À l’inverse, au début du XXème siècle, la plante entière est clairement indiquée par Grieve en cataplasme pour désinflammer les zones douloureuses autour de la fracture et ainsi participer à la consolidation des articulations5.
Le verdict scientifique des tests cliniques
Mais la phytothérapie scientifique rejoint aujourd’hui les phytothérapeutes du XIXème siècle. En 2015, l’Agence européenne du médicament n’indique pas l’usage de la consoude officinale contre les fractures. Cet usage qui relève du mythe n’occulte en rien l’efficacité des racines de grande consoude contre les entorses et les contusions1.
Ses racines pouvant tracer très profondément dans le sol, elle est aussi utilisée en permaculture pour remonter les minéraux du sol. Certains en font même des purins nutritif pour le jardin.
La recette de l’alcoolature de consoude
Voici la recette de l’alcoolature de consoude, à utiliser en cas de plaie non ouverte, d’hématomes, ou de douleurs articulaires :
- Lavez les racines fraîches en les brossant sous l’eau
- Coupez les racines en rondelles, les mettre dans un bocal et recouvrir avec le double de la masse d’alcool à 55 % vol. (pour 50 g de racine de consoude, ajoutez 100 g d’alcool à 55 % vol.).
- Laissez macérer 3 semaines à l’abri de la lumière en remuant régulièrement sans ouvrir le flacon puis filtrez à l’aide d’un linge propre.
- Versez le liquide obtenu dans une bouteille ou un flacon teinté et étiqueter.
L’alcoolature peut se conserver jusqu’à 2 à 3 ans.
Pour l’utiliser, diluez 1 volume d’alcoolature dans 1 à 4 volumes d’eau et utilisez cette préparation en compresses, à appliquer localement.
Comme elle contient des molécules toxiques pour le foie, il est recommandé de n’utiliser cette alcoolature que pour un usage externe sur une peau intacte et une zone peu étendue (pas plus de 4 à 6 semaines par an sans dépasser 10 jours consécutifs).
Pour aller plus loin
Nous vous rappelons que la cueillette sauvage comporte des risques, que vous pouvez découvrir ici les règles et précautions pour la cueillette. Il est indispensable d’être sûr à 100% de vos identifications avant de consommer une plante, quelle qu’elle soit.
Pour apprendre à cueillir 6 plantes sauvages faciles à trouver et à identifier, découvrez notre newsletter gratuite 6 plantes sauvages.
Pour en savoir plus sur les plantes citées, vous pouvez consulter nos vidéos Youtube.
Et pour vous lancer dans des formations en ligne sérieuses et pédagogiques sur ces sujets, rendez-vous sur la page de nos formations en ligne sur les plantes sauvages et les champignons.
Vous pouvez tester nos plateformes au travers de la démo de la formation du cueilleur. L’inscription est gratuite !
La formation du Cueilleur
Pour profiter de toutes ces plantes en toute confiance, nous proposons la formation du Cueilleur ! Notre formation en ligne complète vous permettra d’apprendre à identifier, cueillir, cuisiner et conserver les plantes sauvages.
Sources
1. Eureopean Medicines Agency. Assessment report on Symphytum officinale L., radix Sci. Med. Health. 27 (2015).
2. Goetz, P. & Hadji-Minaglou, F. Conseil en phytothérapie : Guide à l’usage du prescripteur Lavoisier Tec & Doc (2019).
3. Couplan, F. Les plantes et leurs noms Éditions Quæ (2012).
4. Pline l’Ancien. Histoire naturelle de Pline. Tome 2 Firmin-Didot et Cie (1877).
5. Grieve, M. A Modern Herbal Cape (1931).
6. Mattioli, P. A. Pour les douleurs et fractures in Comment. M Pierre André Matthiole Med. Senois Sur Six Livres Ped Dioscor Anazarbeen Matiere Med. (1579).
7. Cazin, F. J. Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes: avec un atlas de 200 planches lithographiées P. Asselin (1868).
8. Duchesne, E. A. Répertoire des plantes utiles et des plantes vénéneuses du globe Jules Renouard (1836).
9. Egasse, Ed. & Dujardin-Beaumetz, G. Les Plantes médicinales indigènes et exotiques, leurs usages thérapeutiques, pharmaceutiques et industriels Octave Doin (1889).
10. Rodin, H. Les Plantes médicinales et usuelles de nos champs, jardins, forêts ; description et usages des plantes, comestibles, suspectes, vénéneuses (1872).