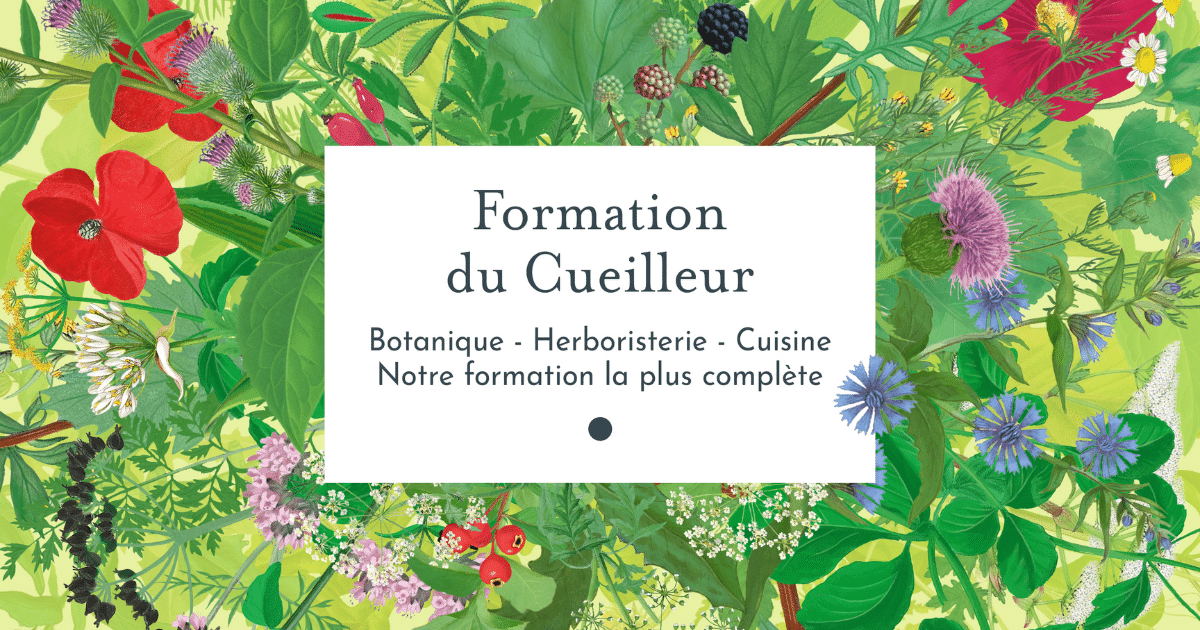Les plantes à fleurs se replient sur elles-mêmes. Avec le déclin documenté et massif des pollinisateurs¹-⁵, les relations de séduction instaurées depuis des millions d’années⁶ seraient de plus en plus délaissées au profit d’une stratégie d’auto-pollinisation : l’autogamie.
Le lien plantes insectes : une co-évolution de longue date
L’insecte représente un mode de transport du pollen privilégié, et assure aujourd’hui la pollinisation de 84% des espèces végétales cultivées et 80% des espèces de fleurs sauvages de l’Union européenne⁷,⁸.
Cette alliance prédominante entre le monde animal et végétal date du Crétacé, il y a environ 100 millions d’années. Oiseaux et insectes deviennent alors des vecteurs de transport du pollen, ouvrant la voie à une formidable co-évolution⁶. Pour appâter l’insecte, les plantes vont rivaliser d’imagination en déployant couleurs, parfums, formes, et vont se mettre à produire du nectar.
Chaque fleur adopte sa stratégie en fonction de l’insecte avec lequel elle est affiliée.
Parmi les adaptations les plus spectaculaires figurent les orchidées du genre Ophrys comme l’ophrys bourdon (Ophrys fuciflora), qui ne produisent pas de nectar et qui ont opté pour le mimétisme. Un pétale un peu particulier chez les orchidées, le labelle, imite à s’y méprendre le corps de femelles d’abeilles solitaires, et la fleur va même jusqu’à copier chimiquement leurs phéromones (messages chimiques)⁹. Le mâle attiré par ce leurre se couvre sans s’en apercevoir de pollen en pensant s’accoupler avec une femelle. En reproduisant ce manège sur l’orchidée suivante, la pollinisation est assurée.
L’insecte, favori parmi les stratégies de reproduction
L’entomogamie, c’est-à-dire la reproduction des plantes via les insectes, bien que largement répandue, n’est pas l’unique solution sollicitée par les plantes. Il en existe d’autres dont l’anémogamie et l’autogamie.
L’anémogamie, c’est le transport du pollen, par le vent afin d’assurer leur descendance. La grande majorité des espèces de Gymnospermes (plantes dont les graines sont à nu), comme les conifères, utilisent ce mode de reproduction contre seulement 18% des Angiospermes (plantes à fleurs)¹⁰. Dans le dernier cas, l’autogamie, la plante s’autoféconde elle-même et s’affranchit ainsi de tout facteur externe.
Les plantes peuvent combiner ces différentes stratégies, hormis les plantes dioïques qui ne peuvent pas s’autoféconder car les fleurs mâles et femelles sont portées par des individus différents. C’est le cas par exemple de l’ortie (Urtica dioica) ou du genévrier commun (Juniperus communis).
Les plantes hermaphrodites, qui possèdent à la fois étamines (organe mâle) et carpelles (organe femelle) au sein de la même fleur représentent 75 % des plantes à fleurs¹¹ et peuvent avoir recours à l’autofécondation, tout comme certaines plantes monoïques (les fleurs sont soit mâles, soit femelles, et sont portées par le même individu) comme le noisetier (Corylus avellana).
Il existe cependant des mécanismes d’auto-incompatibilités qui empêchent l’autogamie chez certaines espèces de plantes hermaphrodites et monoïques, qui dépendent alors entièrement d’un vecteur extérieur¹¹.
La transgression des règles : vers une stratégie de repli
Malgré une majorité de plantes à fleurs présentant une proximité du pollen et des ovules, l’autofécondation reste rare¹².
Les plantes évitent la “consanguinité” et préfèrent normalement brasser leurs gènes par l’intermédiaire du vent et surtout des insectes.
Seulement voilà, les populations d’insectes sont aujourd’hui en déclin et manquent à l’appel de la pollinisation. Les apparats déployés pour plaire à l’insecte deviennent donc caducs.
Une étude récente menée par le CNRS sur une population de violette des champs (également connue sous le nom de pensée des champs, Viola arvensis) du bassin parisien montre que la pratique de l’autogamie a augmenté de 27% depuis les années 2000. Couplée à ce phénomène, les scientifiques observent une réduction de la taille de la fleur de 10% et une diminution de la production de nectar de 20%¹³. Ces constats inquiétants sont révélateurs d’une déstabilisation majeure des relations plantes-insectes.
Un cercle vicieux pour plantes et insectes
Ce type de scénario pourrait conduire à une boucle négative pour les deux parties.
En l’absence de leurs pollinisateurs, les plantes s’autofécondent et produisent moins de nectar. Avec ce type d’adaptation, les populations d’insectes risquent de ne plus trouver la ressource alimentaire nécessaire à leur survie et donc de décliner davantage. Les fleurs, par effet rebond, feront de moins en moins d’efforts pour attirer l’œil et l’odorat de l’insecte et continueront leur adaptation dans la voie de l’autogamie.
La résilience des uns et des autres est donc menacée.
Pour les insectes, déjà fragilisés par la dégradation de leurs habitats et l’agriculture intensive³, c’est le présage d’une pénurie alimentaire. Pour les plantes, l’autogamie les expose à un appauvrissement génétique et donc une moindre résistance face aux changements environnementaux.
Ces bouleversements menacent également l’équilibre de la chaîne alimentaire et de notre alimentation. Plusieurs études¹⁴-¹⁶ montrent que le rendement et la qualité de certaines plantes cultivées, comme la tomate¹⁵ et le colza¹⁷ sont dépendants de la diversité des pollinisateurs. Cette rupture dans la relation plante-insecte est donc une menace pour les plantes et les insectes et plus généralement pour les écosystèmes dont nous faisons partie.
Cela nous rappelle que nous devons nous aussi renouer les liens au plus vite avec le monde vivant.
Changer le scénario
Pour enrayer la catastrophe, nous pouvons chacun à notre échelle changer nos pratiques pour que plantes et insectes restent en bonne relation.
Les insecticides en tout genre (pesticides, néonicotinoïdes, etc.) sont particulièrement néfastes pour la biodiversité et sont à éviter de toute urgence³.
Au printemps, lorsque jardins et parterres se couvrent de fleurs, la tonte coupe les vivres aux insectes pour qui les fleurs sont des ressources vitales, surtout à la sortie de l’hiver. Il est préférable d’attendre ou d’opter à minima pour une tonte différenciée¹⁸ en gardant des îlots de végétation intacts. D’autant plus que nombre de ces fleurs comme le pissenlit ou la pâquerette sont aussi comestibles pour nous autres humains.
Pour aller plus loin
Nous vous rappelons que la cueillette sauvage comporte des risques. Vous pouvez découvrir ici les règles et précautions pour la cueillette. Il est indispensable d’être sûr à 100% de vos identifications avant de consommer une plante, quelle qu’elle soit.
Pour en savoir plus sur les plantes, nous proposons la formation du Cueilleur ! Notre formation en ligne complète vous permettra d’apprendre à identifier, cueillir, cuisiner et conserver les plantes sauvages.
Vous pouvez tester nos plateformes à travers la démo de la formation du cueilleur. L’inscription est gratuite !
La formation du Cueilleur
Pour profiter de toutes ces plantes en toute confiance, nous proposons la formation du Cueilleur ! Notre formation en ligne complète vous permettra d’apprendre à identifier, cueillir, cuisiner et conserver les plantes sauvages.
Sources
- Thomas, J. A. et al. Comparative Losses of British Butterflies, Birds, and Plants and the Global Extinction Crisis Science. 303, 1879‑1881 (2004).
- Goulson, D., Lye, G. C. & Darvill, B. Decline and Conservation of Bumble Bees Annu. Rev. Entomol. 53, 191‑208 (2008).
- Van Der Sluijs, J. P. Insect decline, an emerging global environmental risk Curr. Opin. Environ. Sustain. 46, 39‑42 (2020).
- Biesmeijer, J. C. et al. Parallel Declines in Pollinators and Insect-Pollinated Plants in Britain and the Netherlands Science. 313, 351‑354 (2006).
- Hill, J. K. et al. Responses of butterflies to twentieth century climate warming: implications for future ranges Proc. R. Soc. Lond. B Biol. Sci. 269, 2163‑2171 (2002).
- Pelt, J.-M., Jacques Girardon, Monod, T. & Mazoyer, M. La plus belle histoire des plantes. Les racines de notre vie (1999).
- Collen, B., Böhm, M., Kemp, R. & Baillie, J. Spineless: status and trends of the world’s invertebrates Zoological Society of London (2012).
- Janzen, D. H. Lost Plants Oikos. 46, 129 (1986).
- Bergstrom, G. Relations chimiques entre les Orchidées et leurs pollinisateurs Bull. Société Entomol. Fr. 90, 1223‑1228 (1985).
- Friedman, J. & Barrett, S. C. H. A Phylogenetic Analysis of the Evolution of Wind Pollination in the Angiosperms Int. J. Plant Sci. 169, 49‑58 (2008).
- Fobis-Loisy, I. & Gaude, T. Contrôle de la fécondation par des mécanismes d’auto-incompatibilité Biol. Aujourdhui. 204, 33‑42 (2010).
- Thomas, R. et al. Petite flore de France : Belgique, Luxembourg, Suisse – Guide d’identification : 100 families, 500 genres, 100 espèces Belin (2016).
- Acoca‐Pidolle, S. et al. Ongoing convergent evolution of a selfing syndrome threatens plant–pollinator interactions New Phytol. nph.19422 (2023).
- Garratt, M. P. D. et al. Avoiding a bad apple: Insect pollination enhances fruit quality and economic value Agric. Ecosyst. Environ. 184, 34‑40 (2014)
- Greenleaf, S. S. & Kremen, C. Wild bee species increase tomato production and respond differently to surrounding land use in Northern California Biol. Conserv. 133, 81‑87 (2006).
- Bartomeus, I. et al. Contribution of insect pollinators to crop yield and quality varies with agricultural intensification PeerJ. 2, (2014).
- Bommarco, R., Marini, L. & Vaissière, B. E. Insect pollination enhances seed yield, quality, and market value in oilseed rape Oecologia. 169, 1025‑1032 (2012).
- LPO. Tonte et végétation Ligue de Protection pour les Oiseaux. Disponible sur : https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/s-engager/en-tant-que-citoyen/pour-aller-plus-loin/tonte-et-vegetation/.